Chapitre
16 : le monde quantique /onde lumineuse
Lampe à vapeur de sodium (5,5 points 2007/09
Polynésie )
Lors d'une séance de
travaux pratiques, des élèves utilisent une lampe à vapeur de sodium. Celle-ci
émet une lumière jaune-orangé. Afin de comprendre l'origine de cette couleur,
ils consultent leur livre de physique dans lequel figure le diagramme
énergétique simplifié de l'atome de sodium reproduit ci-dessous :
 Le niveau n = 1 est celui de plus basse
énergie.
Le niveau n = 1 est celui de plus basse
énergie.
Données :
•
masse
de l'électron : me = 9,10.10-31 kg
•
masse
du proton : mp = 1,67.10-27
kg
•
constante
de gravitation universelle : G = 6,67.10-11 SI
• charge électrique élémentaire : e = 1,60.10-19 C
• constante de Planck : h = 6,63.10-34 J.s
• célérité
de la lumière dans le vide : c = 3.108 m.s-1.
1eV = 1,6x10-19 J
aide au calcul : ![]()
1. Étude de l'atome de
sodium
1.1. Donner la composition de l'atome de
sodium ![]() .
.
1.2.
Le
diagramme énergétique simplifié de l'atome de sodium montre que l'énergie ne
peut prendre que certaines valeurs. Comment qualifie-t-on alors l'énergie ? La
mécanique de Newton permet-elle d'expliquer ces niveaux énergétiques ?
1.3.
La
couleur jaune-orangé correspond à une transition concernant les deux premiers
niveaux (n = 1 et n = 2). Représenter cette transition par une flèche sur le
diagramme énergétique donné en annexe à rendre avec la copie dans le cas
d'une émission. Calculer la longueur d'onde ![]() de la radiation émise par la lampe.
de la radiation émise par la lampe.
1.4.
Déterminer,
d'après le diagramme, la plus courte longueur d'onde de la radiation que peut
émettre l'atome de sodium. On arrondira les données avec 1 chiffre significatif
avant d’éffectuer . Préciser, en le justifiant, à quel domaine spectral
appartient cette radiation.
2.
Dispersion de la lumière émise
Afin d'étudier la radiation de couleur
jaune-orangé, les élèves décident de l'isoler des autres radiations
éventuellement émises par la lampe. Pour cela ils réalisent la dispersion de la
lumière émise grâce à un prisme en verre.
2.1.
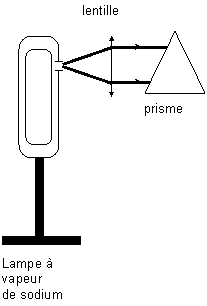 Le verre est un milieu dispersif, expliquer
ce terme.
Le verre est un milieu dispersif, expliquer
ce terme.
2.2.
La
fréquence de la radiation jaune-orangé est-elle différente dans le verre et
dans l'air ?
2.3.
À
cette fréquence, l'indice de réfraction du verre pour la radiation jaune-orangé
est n = 1,52. Après avoir défini l'indice d'un milieu transparent, calculer la
valeur de la longueur d'onde ![]() de la radiation jaune-orangé dans le verre.
de la radiation jaune-orangé dans le verre.
2.4.
À la
sortie du prisme, on sélectionne la radiation jaune-orangé de longueur d'onde![]() . Comment
qualifie-t-on une telle lumière ?
. Comment
qualifie-t-on une telle lumière ?
3.
Diffraction
de la lumière jaune-orangé
Les élèves décident d'utiliser le phénomène
de diffraction pour vérifier la valeur de la longueur d'onde l de la radiation jaune-orangé. Pour cela
ils disposent une fente fine verticale sur le trajet de la lumière.
3.1.
Les
élèves ont à leur disposition trois fentes de largeur a différente. Quel doit
être leur choix afin que le phénomène de diffraction soit le plus marqué
possible ?
3.2.
Le
phénomène de diffraction existe-t-il dans d'autres domaines que celui de la
lumière ? Si oui, donner un exemple avec un schéma explicatif.
3.3.
Derrière
la fente, à une distance D = 1,0 m, les élèves disposent un écran
perpendiculairement à la direction de propagation de la lumière. Dessiner
l'allure de ce qu'on observe sur l'écran sur l'annexe à rendre avec la copie.
3.4.
Dans
la pratique, la figure de diffraction est peu lumineuse. La distance L, entre
les deux extinctions de part et d'autre de la tache centrale, a néanmoins pu
être mesurée à l'aide d'une lunette de visée. La valeur obtenue est L = 2,4 cm.
Montrer que la longueur d'onde peut
s'exprimer par ![]()
3.5.
.
Faire l'application numérique sachant que la fente a une largeur a = 50 µm.
ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE
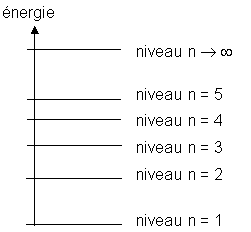 1.3
1.3
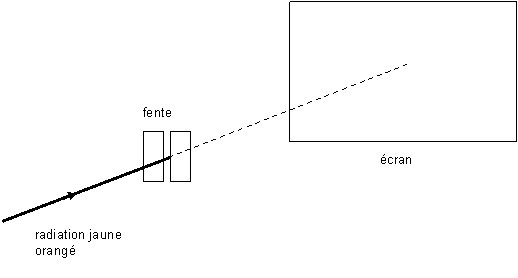
3.3